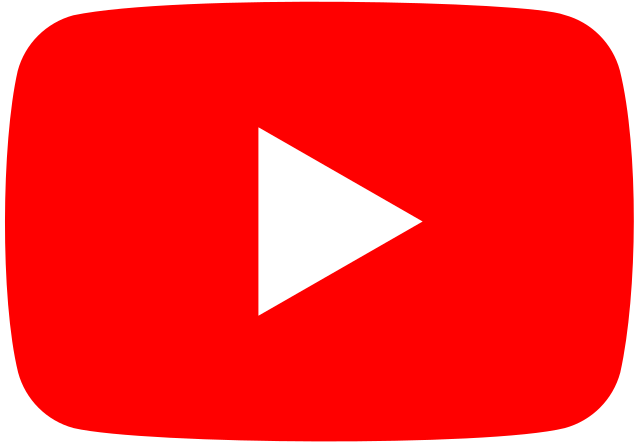Plaidoyer pour une critique ludique engagée

Un art ne le devient pas seul. Il naît comme pratique artisanale puis gagne ses lettres de noblesse par l’émergence d’une façon de voir qui le grandit d’une nouvelle dimension : l’interprétation. C’est parce que l’on prête à une production créative un sens qui excède sa seule fonction qu’elle devient œuvre.
Ce que l’on appelle art pourrait bien n’être tel que parce qu’il existe un regard sur l’art. C’est ainsi que j’entends la formule attribuée à Marcel Duchamp : « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ».
Sauf que les regardeurs sont aussi bien les artistes que le public. Les uns comme les autres sont légitimes à produire un discours qui élargit la portée de l’œuvre — discours qui, en retour, inspire d’autres artistes à y inscrire davantage de sens, et d’autres regardeurs à y voir plus et mieux.
En soi, tout le monde peut — d’aucuns diront devrait — s’emparer de cet acte de vision. Mais comme tout exercice de pensée, il suppose une éducation du regard et une capacité à frotter ses idées au silex, compétence qui ne se forge qu’avec effort et pratique. Toute personne qui consacre une part significative de son temps à cet exercice, qu’elle le fasse professionnellement ou non, rejoint alors les rangs de ce que l’on appelle, dans le champ culturel : la critique.
Souvent mal comprise, la critique mène pourtant — ou devrait mener — trois combats essentiels :
- Étendre le champ d’expression de l’œuvre, en explorant ce qu’elle dit d’elle-même et de la société qui l’a produite, en résonance avec son temps ;
- Légitimer l’œuvre et l’artiste, et inscrire leur place dans l’histoire des formes ;
- Éduquer à l’interprétation du réel, et contribuer ainsi à l’émancipation individuelle par un rapport au monde plus éclairé.
Ce rôle n’est donc ni vain, ni anodin.
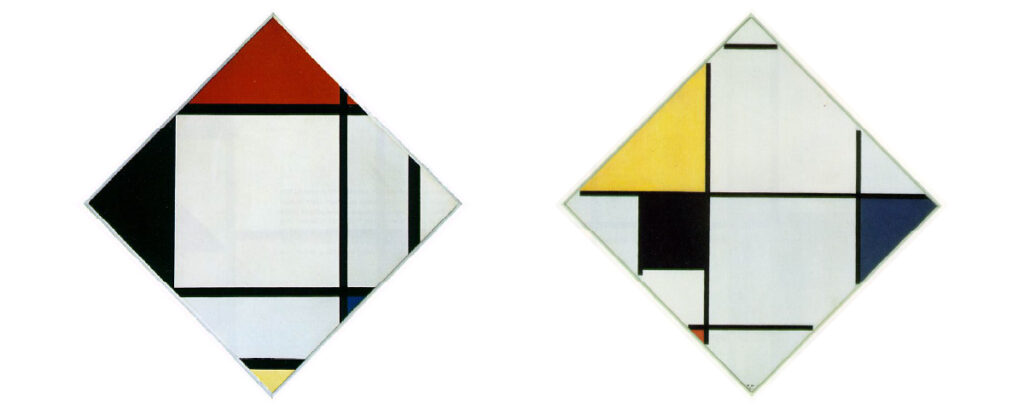
Quid du jeu ?
Le monde du jeu de société, à mesure qu’il se structure comme industrie, objet culturel et matière à penser, prend lentement le trajet d’une maturité propre aux formes d’art en devenir.
Mais le jeu comme art, lui non plus, ne fabriquera pas seul — il a besoin de sa critique.
D’où ces questions légitimes qui motivent cet article : où en est la critique ludique aujourd’hui ? A-t-elle un jour existé ? Quels sont ses espaces, ses formes, ses ambitions ?
Trop peu de prises de parole, en dehors du champ universitaire et d’initiatives éparpillées, embrassent cet exercice à la hauteur de ses enjeux. L’espace médiatique est saturé par une presse d’opinion affable, portée par des magazines, des sites et des chaînes d’influence qui se cantonnent le plus souvent au commentaire de l’actualité marchande. Les jeux y sont « sympas », « fun », « efficaces », « mignons », « addictifs », « malins »… mais ne semblent jamais être autre chose que cela. L’argumentaire tourne sur lui-même et le jeu reste enfermé dans le jeu.
Cette atrophie du discours critique, symptomatique de notre époque et observable dans d’autres champs culturels, est problématique. Pourquoi ? Parce qu’à terme, en devenant insidieusement la norme, elle affaiblit nos défenses immunitaires collectives, c’est-à-dire notre capacité à décrypter les fables qui nous bercent — qu’elles soient politiques, publicitaires ou idéologiques — et donc à se prémunir contre les manœuvres qui iraient à l’encontre du bien commun.
Pour qu’une société reste en bonne santé, nous avons collectivement un devoir de résistance — celui d’armer nos esprits. La critique, aussi subjective et contestable soit-elle, est l’une des formes de cette résistance.
À celles et ceux qui souhaitent écrire sur les œuvres ludiques, conscients que le jeu est aussi un espace de sens à investir, voici quelques garde-fous à méditer avant de prendre la plume.

Non, paraphraser les règles du jeu ou l’argumentaire de l’éditeur n’est pas une critique
Les jeux, à leur sortie de la grotte éditoriale, arrivent dans l’espace public comme des créatures médiatiques — avec leurs éléments de langage.
Une description alléchante, des slogans mémorables et quelques mots-clefs soigneusement choisis pour toucher le public cible et permettre de situer le jeu dans le paysage saturé des sorties. Les termes sont positifs ou cinglants, joyeux ou dramatiques, mais toujours séduisants : ils sont publicitaires. Jusque là, rien d’alarmant — les vagues font leur boulot, comme dirait Askehoug, et les entreprises font leur travail.
Le problème surgit lorsque cet argumentaire de vente vient infuser, voire perfuser, les colonnes d’un article consacré au jeu — dans ce cas, la critique ne fait pas son travail.
Il est illusoire d’espérer conserver une distance critique en restant collé à une image du jeu fabriquée par ceux qui la vendent. Non pas que les informations soient nécessairement fausses — la plupart des éditeurs s’efforcent d’être justes, quoique parfois racoleurs, dans la description de leurs produits —, mais une pensée autonome doit s’affranchir de toute complaisance. Un point de vue, subjectif par essence, doit s’assumer comme tel : l’important n’est pas de décrire le plus fidèlement possible un jeu, mais d’en dire quelque chose d’original, de produire un regard singulier.
À cette absence de distanciation s’ajoute un travers devenu quasi systémique : la paraphrase des règles. Bien que les éditeurs, épaulés par l’écosystème pléthorique des vidéos-règles et des let’s play, remplissent parfaitement cette fonction explicative, trop d’articles et de vidéos se contentent de dérouler, parfois in extinso, le mode d’emploi d’un jeu comme s’il s’agissait déjà d’un travail d’analyse. Ce bégaiement revient à réduire l’objet à son usage — l’équivalent d’une critique de film qui se contenterait de raconter le scénario.
Les règles sont bien entendu à analyser et à méditer. C’est l’un des apports passionnant de l’analyse structurelle ou de ce que l’on nomme ailleurs la rhétorique procédurale : la capacité d’un système de règles à exprimer et transmettre des idées. Que disent les mécaniques d’un jeu en regard de son thème ? Que racontent les dynamiques qu’elles produisent autour de la table ? Que peuvent bien dire de nous ces contraintes que l’on s’impose, nécessaires à la production d’une expérience ludique ? Voire : a-t-on besoin de connaître les règles d’un jeu pour en apprécier l’interprétation que la critique en fera ?
Les pistes de réflexion ne manquent pas, mais répéter les règles comme des perroquets ne nous ferra jamais chanter comme des rossignols.

Oui, on se passe tout aussi bien de votre avis
La fonction de la critique, telle que je l’entends ici, n’est pas de distribuer des bons points, mais de creuser patiemment des trous dans les murs et de rendre visibles les structures qui nous entourent — dont les jeux sont aussi porteurs. La critique peut dès lors remplir sa fonction de pierre à aiguiser : son rôle n’est pas d’émousser nos esprits par le confort du consensus, mais au contraire de les affûter.
Dans cette perspective, dire « j’aime » ou « je n’aime pas » n’a que peu d’intérêt. L’expression de votre goût personnel, pris isolément, ne m’apprend rien : c’est avec votre pensée, étrangère et diverse, que je souhaite la rencontre.
Le goût, s’il est un point de départ légitime, ne constitue pas pour autant un argument. Cela n’empêche pas que la prescription reste l’une des grandes tentations de la critique. Être celle ou celui qui guide le choix des autres est une gratification convenue dans cet exercice qui, du reste, n’apporte que peu de récompense matérielle.
De leur côté, les vendeurs — éditeurs, distributeurs, boutiques — ne peuvent être autre chose que des prescripteurs. Leur fonction première étant la survie économique, leur parole est naturellement informative et persuasive : elle est, pour le meilleur et pour le pire, publicitaire. Malheureusement, ce message a formaté les articles d’opinion et de recommandation qui pullulent dans cet écosystème — rien ne génère autant de trafic que le fameux « Les neuf jeux indispensables pour Noël ». La question est de savoir comment produire une autre forme de discours : assurément par une autre forme de langage.
À l’évidence, toute prise de parole sur une œuvre exerce une influence. S’exprimer, c’est braquer un projecteur sur un sujet, et donc, mécaniquement, éveiller l’attention, à la manière d’un journal télévisé qui sélectionne ou laisse de côté les informations de son choix. Parler d’un jeu, en bien ou en mal, c’est déjà lui accorder de l’importance — et parfois, une mauvaise réputation vaut mieux qu’une absence totale de considération.
La critique possède donc inévitablement une dimension prescriptive. Mais c’est précisément pour cette raison que l’expression d’un jugement de goût est, au mieux, un doublon superflu, et au pire une façon de se placer soi-même sous les feux de la rampe. Des avis, il n’y a que ça autour de nous — dans les commentaires de vidéo, sur les forums, sur BoardGameGeek ou MyLudo, sur les sites marchands. Ce dont nous avons besoin, c’est de points de vue.

Non, ChatGPT n’écrira pas une critique à votre place
Dans le domaine de l’écriture, l’intelligence artificielle (IA) issue des LLM (Large Language Model), est un assistant de rédaction performant : il reformule et synthétise avec fluidité, équilibre les phrases (quoique souvent de façon monotone et prévisible), et peut parfois pointer avec justesse les angles morts d’un raisonnement. Son utilisation parcimonieuse et en conscience (c’est là tout l’enjeu), est dans la marche du temps — il n’y a pas lieu de partir en croisade contre cet usage-là d’une technologie qui déferle sur notre quotidien.
Le problème est qu’avant de pouvoir réécrire sous l’assistance des machines… il faut avoir déjà écrit. Cette étape initiale, de loin la plus difficile, consiste à créer la matière première d’un texte : un ensemble de mots plus ou moins organisés qui retranscrivent une pensée plus ou moins mature. Ce premier jet instinctif est comme une pierre brute remontée de la mine : il est encore à nettoyer, à polir et à raffiner. À partir de là s’orchestre un lent travail d’orfèvrerie jusqu’à la version finale du texte. C’est au cours de cette lente phase de polissage que va se structurer votre pensée et que vont mûrir vos idées. Oui, la critique demande un effort.
Il faut bien comprendre que l’IA n’a pas de réelle conscience de la pertinence d’une idée, ni même de ce qu’est une idée au sens phénoménologique. Elle manipule des symboles (compréhension syntaxique et sémantique abstraite) et raisonne comme si ces structures étaient opérantes. Les idées ne sont pour l’IA que des poids attribués à des variables. Elle peut certes démêler votre raisonnement et le reformuler, mais elle ne peut pas avoir de nouvelles idées à votre place sur quelque chose qui n’a pas encore été produit, comme par exemple un jeu de société tout juste paru… ou toute autre association nouvelle et inattendue de deux concepts entre eux.
Mais au-delà de cette limite structurelle, l’IA ne peut pas remplacer ce que la critique a de plus précieux : sa prise de risque. Une critique n’est pas un simple compte rendu ou une analyse scolaire comme le serait un bon vieux commentaire de texte. La critique est une proposition d’interprétation, un point de vue profondément personnel qui, de fait, nous expose.
Au fond, mon point n’est pas de trancher sur la capacité de l’IA à nous souffler ou à nous inspirer des idées — tant mieux si elle y parvient — , ni de chercher à dire « c’est mieux » ou « c’est moins bien », dans une sorte de comparaison égotique avec la machine (je renvois sur ce sujet au concept de « honte prométhéenne » théorisé par Günther Anders dès 1956, dans lequel les hommes se sentiraient désormais inférieurs aux machines qu’ils ont créé). Je tempête plutôt contre notre empressement au renoncement. Sans même parler de la dette cognitive dans laquelle risque de rapidement nous plonger l’IA (if you don’t use it, you lose it), c’est ce renoncement qui gangrène la critique ludique (entre autres) et, in fine, plonge le jeu dans un même bouillon fade.
La marche du monde et la vitesse du train de marchandise (duquel nous n’avons pas encore sauté), fait que la toile pullule de textes « bien écrits », mais terriblement creux, parce que les idées de leurs auteurs ont justement été abdiquées au profit de celles, statistiquement, agrégées par l’IA.
Pourquoi alors nous y méprenons-nous aussi facilement ?
Parce que l’IA produit des formes qui ressemblent à des idées, exactement comme un faux en peinture — c’est extrêmement convaincant et on pourrait l’accrocher dans son salon. Mais une idée déborde des mots qui la formulent et pénètre notre esprit avec ses craquelures, ses aspérités et sa puissance évocatrice. Un texte critique a besoin de cette source d’énergie brute, qui émerge de la combinaison entre un regard unique (parce que forgé par une histoire personnelle) et un effort de friction, entre l’objet (l’œuvre) et le sujet (le regardeur).
Ce maintien de notre capacité à la distinction en le faux et le vrai — rappelons l’origine du mot critique, du grec ancien kritikos, capable de discernement, de jugement, et du dérivé krinein, séparer, choisir, décider, discerner — n’est rien de moins que l’un des enjeux de société les plus important de notre siècle. Autant se retrousser les manches et utiliser l’IA pour mieux cerner ce qui nous en distingue.

Non, l’actualité de l’industrie n’a pas besoin d’être celle de la critique
Comme le dit régulièrement le théoricien Jean-Baptiste Thoret à propos du cinéma, nous avons besoin de repenser la notion d’actualité. La vitesse du monde, accélérée dans sa perception par l’omniscience des images, nous donne l’impression que pour exister, il faut être à la mode — c’est-à-dire à jour des dernières sorties.
Force est de constater qu’avec plusieurs centaines de nouveaux titres par an, l’industrie du jeu (physique ou numérique) impose un régime d’attention fondé sur la nouveauté permanente. Les éditeurs, distributeurs et boutiques, comptent naturellement sur des relais d’opinion réactifs pour faire sortir leurs jeux du lot. C’est leur rôle. Mais ce diktat éditorial est en contradiction avec l’ADN de la critique : penser dans la durée.
L’impératif d’écrire au moment précis où les jeux sortent, combiné à la cadence effrénée des parutions, impose en effet un rythme qui n’est que rarement celui de la prise de recul. Certes, l’expérience et l’intuition peuvent faire jaillir de bonnes idées en un temps contraint. Mais l’une des forces fondamentales de la critique est précisément de pouvoir s’affranchir de la temporalité du marché. Parce qu’elle est personnelle, située, idiosyncrasique, elle peut choisir ses objets et leur donner un sens actuel.
Le problème de fond est qu’à la longue, ce régime de l’instantanéité entretient et standardise une façon de parler du jeu, mais aussi dogmatise une certaine posture à l’intérieur du monde ludique. Tout devient sympa et mignon, fun et gentil, comme si le jeu ne pouvait pas exister en dehors de ce que j’appelle la « guimauve » : un état perpétuel de mollesse et de niaiserie.
Dès lors que l’on comprend qu’écrire sur un jeu — quelle que soit son ancienneté — revient à réfléchir sur le monde qui l’a produit et sur celui dans lequel nous vivons, la notion d’actualité devient relative. Ce ne sont pas les sorties qui font l’actualité de la critique, mais les idées qu’elle met en circulation.

Oui, une critique c’est aussi faire dialoguer deux visions du monde
Le jeu n’est pas une parenthèse dans le réel : il en est une mise en forme du réel. Il condense des valeurs, des normes, des imaginaires, des rapports au temps, au conflit, à la coopération. Aucune hiérarchie préalable ne devrait donc disqualifier un objet ludique aux yeux de la critique. Un jeu dit « classique » (comme le Skyjo ou le Loup-Garou), un blockbuster « mainstream » (Unmatched, Pandemic Legacy, Jekyll vs. Hide), un jeu traditionnel (la belote), un escape game sous licence (Le Bureau des légendes) ou même un jeu obscur et confidentiel (Bot Factory) ont tous quelque chose à nous apprendre — non parce qu’ils se valent, mais parce qu’ils témoignent chacun, à leur manière, des conditions culturelles qui les ont rendus possibles. De la même façon, un jeu jugé « mauvais » peut être aussi éclairant qu’un chef-d’œuvre, ne serait-ce qu’en tant que symptôme culturel menant à une réflexion sur l’état de la société qui l’a rendu possible.
Au fond, l’œuvre est toujours un point de départ. Pour les artistes comme pour les critiques, elle agit comme un prisme : un objet situé à travers lequel se disent une époque, une sensibilité, une manière d’habiter le monde. Écrire sur une œuvre, ce n’est donc jamais seulement parler d’elle — c’est aussi, consciemment ou non, parler de soi.
Par pudeur, cette confession involontaire (au sens nietzschéen) ne s’affiche pas ouvertement : elle est à retrouver en creux. Faire la critique d’un jeu de société ou d’un jeu vidéo, que des observateurs hâtifs relèguent parfois hors de la « vraie vie », est justement d’assumer la rencontre entre deux visions exprimées plus ou moins inconsciemment par leurs auteurs respectifs : celle de l’œuvre, fruit d’un ensemble de facteurs (les auteurs d’un jeu sont rarement les seuls décisionnaires de tous les choix artistiques de la version éditée), et celle du regardeur, qui va chercher dans l’œuvre des éléments qui lui permettent de construire son regard sur le monde.
Mais une vision du monde ne surgit pas ex nihilo : elle se cultive et se sculpte. Elle naît de la conduite de sa propre vie, de sa vision personnelle forgée au fer de sa culture et son environnement, tout autant que par un effort constant pour affiner — et affirmer — son regard.
Reste alors une ligne de crête : celle qui sépare l’interprétation étayée de la projection assumée. Tout ne peut pas être prêté à une œuvre sans qu’elle y résiste. Certains textes épousent étroitement ses contours ; d’autres s’en éloignent. C’est précisément sur ce fil tendu entre décryptage sensé et rêverie poétique que marche la critique.
Là où certains auteurs, en s’inscrivant dans une tradition anti-herméneutique, redoutent que la critique fige le sens de l’œuvre — et nous prive ainsi de l’expérience sensible de la rencontre — je crains surtout qu’en renonçant au travail d’interprétation, on laisse d’autres discours, marchands ou médiatiques, consensuels et normalisés, le faire à notre place.
À mon sens, la critique n’a ni vocation à dire la vérité d’un jeu, ni à en constituer l’horizon indépassable. Il ne s’agit pas d’un concours de lancer de fléchettes pour essayer de « deviner » la pensée de l’auteur ou réduire l’œuvre à un message caché. La critique est un dialogue : une confrontation entre un objet qui résiste et un regard qui s’expose. C’est dans cette relation, résolument subjective et assumée comme telle, que se joue la valeur d’un texte critique.

Oui, vous avez le droit de ne pas être d’accord
Derrière ce plaidoyer, je défends une certaine idée de la critique ludique — située, exigeante, et assumée comme telle. Mais il existe une multitude de façons de parler du jeu et je ne prétends ni à l’universalité, ni à l’exclusivité. Même considérer le jeu comme un objet politique, posture que je revendique par ailleurs ou que peuvent véhiculer certaines initiatives comme Un stand d’ailleurs ou encore le Manifeste métaludique pour ne citer qu’elles, n’est qu’un regard parmi d’autres, qui n’a bien sûr pas le monopole de la pensée critique.
En résumé, ce texte n’est pas une liste de commandements, mais un appel aux armes. Le combat ? En voici les fronts :
- La critique ludique doit s’affranchir du discours publicitaire qui entoure les produits ;
- Elle ne se confond ni avec l’expression d’un goût personnel, ni avec la prescription d’opinion ;
- Elle doit se méfier du renoncement programmé dans lequel nous entraîne l’écriture assistée par IA, lorsque celle-ci remplace la pensée au lieu de la stimuler ;
- Elle a toute légitimité à exister hors de la temporalité du marché : son actualité est conceptuelle, pas chronologique ;
- Elle est, enfin, l’expression d’une vision du monde singulière, incarnée, et donc vivante et discutable.
Alea jacta est.
Auteur :
— Publié le
Gardez l’esprit ludique.
Découvrez aussi la chaîne Ludogamie sur Youtube, où se rencontrent philosophie ludique, esprit critique et créativité !